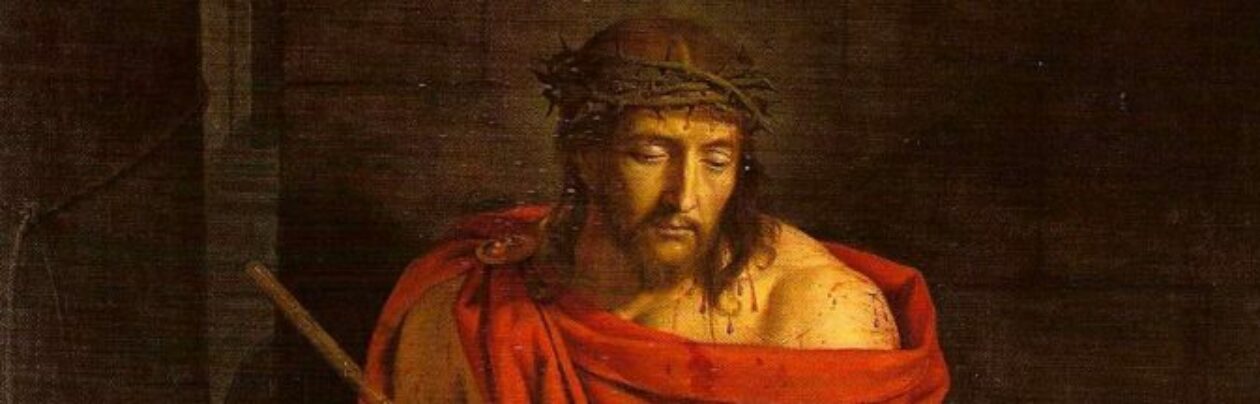Port-Royal, une mémoire vive
Port-Royal n’est pas seulement le nom d’un abbaye de la Vallée de Chevreuse: c’est un symbole. Le monastère, rasé depuis plus de trois siècles, continue de représenter le la dignité dans l’adversité, la fidélité à la conscience affirmée contre la violence des persécuteurs, le refus obstiné de toute compromission lorsque vacille la justice. Depuis le XVIIe siècle, Port-Royal incarne une facette essentielle de l’esprit français : celle qui résiste, qui pense librement, qui oppose à l’arbitraire du pouvoir la force tranquille de la vérité.
Ce n’est pas un hasard si le Musée des Granges, conçu après la Seconde Guerre mondiale, fut inauguré par André Malraux en 1962. Gaulliste fervent et chantre de l’insurrection de l’esprit, Malraux voyait alors dans la persécution des religieuses de Port-Royal un mythe fondateur de la dissidence moderne. Rejeté par les catholiques, le souvenir de Port-Royal fut au contraire revendiqué, siècle après siècle, par les esprits forts, les rationalistes laïcs, les républicains, les résistants — de Sainte-Beuve à Renan, jusqu’à Malraux lui-même.
Port-Royal a toujours été une référence et un modèle pour celles et ceux qui, à travers les siècles, ont cru devoir s’insurger contre les abus. Persécuté par Richelieu, détruit de fond en comble par Louis XIV, sali par l’Église, réduit au silence par les puissants, Port-Royal n’en a pas moins traversé le temps, irradiant, par-delà sa ruine, une idée inaltérable de la droiture.
Un moment essentiel de l’histoire des femmes
Du XIIe au XVIe siècle, Port-Royal n’était pourtant qu’une abbaye féminine sans histoire, située en vallée de Chevreuse, près de Magny-les-Hameaux, aux abords de l’actuelle ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. On peut aujourd’hui en visiter les ruines, miraculeusement épargnées jusqu’ici par l’urbanisation galopante.
C’est au XVIIe siècle que Port-Royal devient le centre d’un foyer spirituel et intellectuel d’une influence étonnante dans une époque pourtant marquée par l’absolutisme royal et la centralisation religieuse. La réforme monastique, les controverses théologiques, l’éducation des Petites-Écoles, les figures de Pascal, de Racine, des Solitaires, transforment cette abbaye féminine retirée en haut lieu de la pensée, de la foi et de la résistance.
Comment cette paisible abbaye de femmes, nichée en Île-de-France, en vint-elle à devenir l’un des plus puissants foyers d’opposition au pouvoir de Richelieu, de Mazarin, puis de Louis XIV ? Pourquoi des religieuses catholiques vouées au silence, soutenues par quelques amis laïcs, choisirent-elles de tenir tête à l’autorité croissante de Rome et du Pape, jusqu’à incarner, par leur combat même, un symbole de la liberté de conscience ? Comment cette aventure avant tout religieuse put-elle devenir, au fil du temps, une référence fondatrice pour l’école républicaine elle-même ?
Retracer l’histoire de Port-Royal, c’est aussi écrire une page essentielle de l’histoire des femmes en France, aux plans religieux, politiques, mais aussi culturels, littéraires et artistiques. Pour ces intellectuelles de premier plan que furent Jacqueline Arnauld, Jacqueline Pascal ou Angélique de Saint-Jean, prendre le voile, c’était choisir la liberté : celle d’étudier, d’écrire, d’enseigner — mais aussi celle d’affirmer les droits de la conscience contre les puissants.
Mais les femmes qui pensent sont dangereuses. Les pouvoirs civil et ecclésiastique entreprirent de les soumettre. On les accusa d’hérésie, d’insubordination. Elles connurent les calomnies, les privations, la prison, l’exil. Elles subirent les vexations policières, la vindicte des évêques.
Rien n’y fit. Rien ne les fit fléchir. Et si elles succombèrent sous les coups de leurs puissants adversaires, elles triomphèrent néanmoins, par-delà l’échec et la mort. Jamais leur mémoire n’a pu être occultée.
Ni la persécution de Louis XIV, qui fit détruire leur abbaye et disperser leurs cendres. Ni l’obscurantisme de l’Église catholique, qui s’emploie jusqu’à nos jours à salir leur image : « Sept fois démones ! » s’exclamait encore le pape François en 2022, damnant en pleine curie, et sans craindre le ridicule, ces quelques femmes qui osèrent, il y a quatre siècles, défier son magistère.
Le site : un portail universitaire consacrer à l’histoire littéraire et artistique de Port-Royal
C’est à la mémoire de ces femmes, et de ces hommes qui furent leurs alliés, que ce site est consacré. « Port-Royal, entre ombres et lumières. Histoire, art et littérature dans la France du XVIIe siècle » est rattaché au Collège XVII–XVIII du laboratoire CÉRÉdI (Centre de recherche Éditer–Interpréter, Université de Rouen Normandie, UR 3229).
Ce site constitue à la fois une invitation à découvrir la vie et les œuvres des individus qui marquèrent l’histoire de Port-Royal, et un portail scientifique rassemblant les activités du laboratoire liées à ce foyer intellectuel. Les colloques et publications concernant la réception de Pascal et Racine depuis le XVIIe siècle constituent la principale contribution du CÉRÉdI à la connaissance de Port-Royal. Le centre soutient également des travaux sur la dévotion et l’augustinisme moderne, qui accordent à Port-Royal une place centrale.
Une section Actualités recense les événements et les publications récentes autour de l’abbaye, notamment dans ses dimensions littéraire, artistique et philosophique.